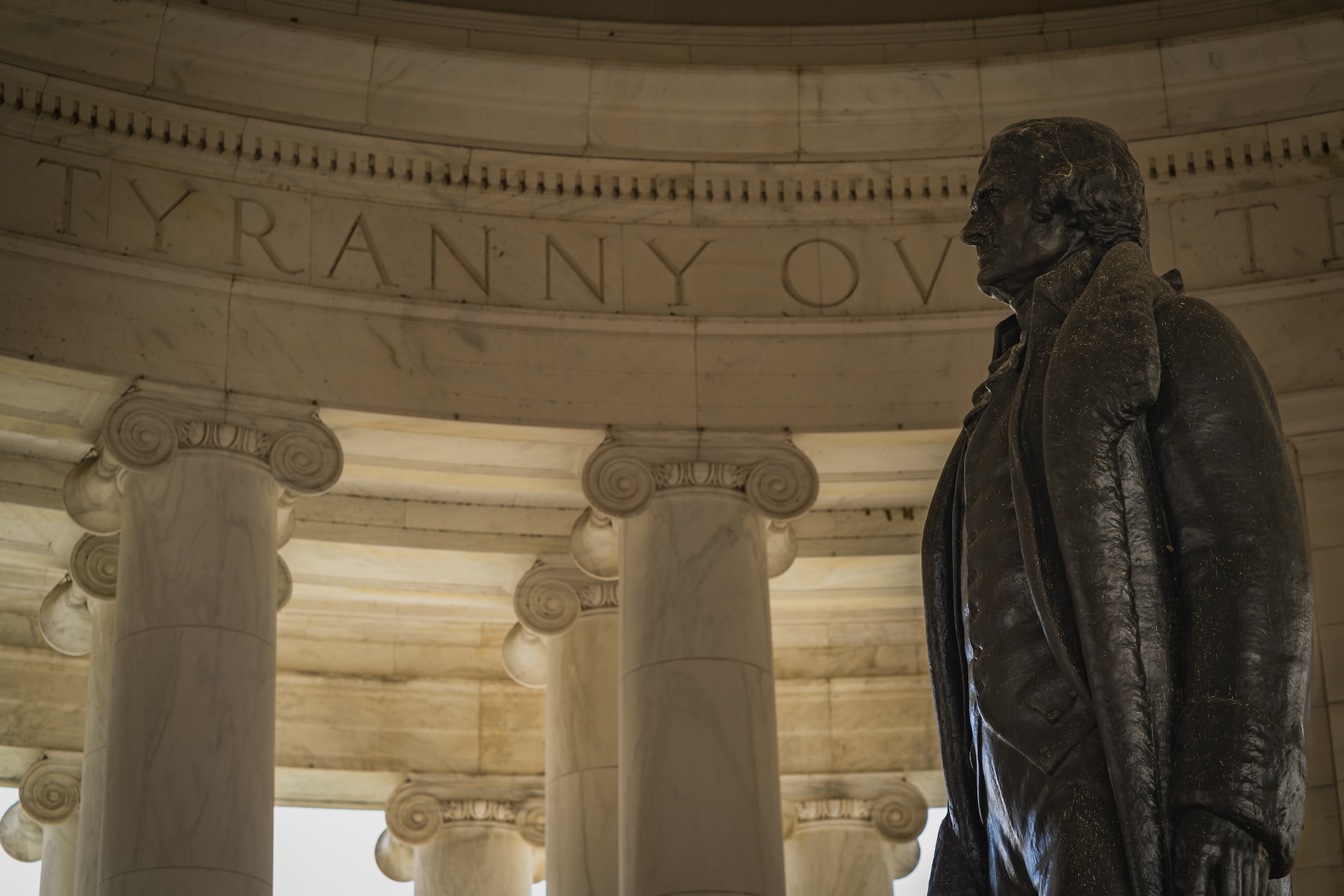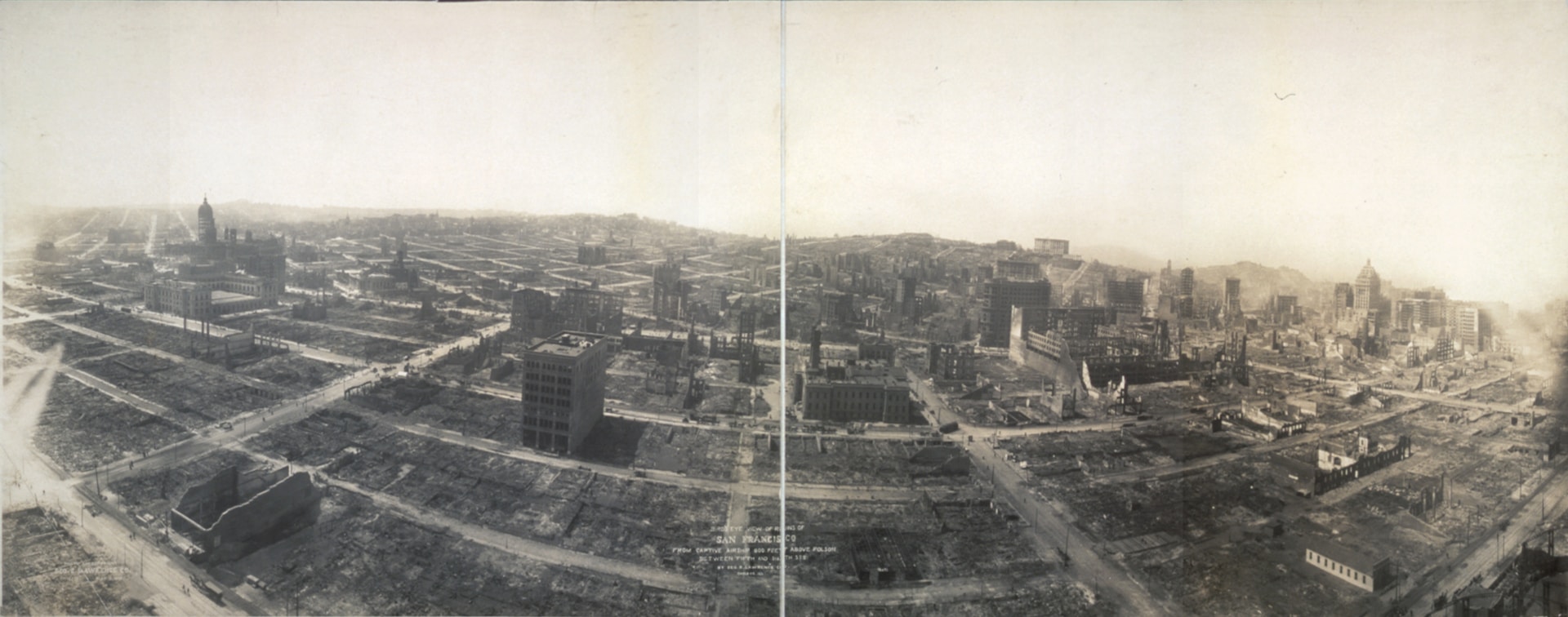Un héritage Vanderbilt à couper le souffle
The Breakers est bien plus qu’une simple maison ; c’est un palais inspiré par la Renaissance italienne, érigé par Cornelius Vanderbilt II. Après un incendie dévastateur en 1892, sa femme Alice Claypoole Vanderbilt a confié la conception de ce nouveau chef-d’œuvre à l’architecte Richard Morris Hunt. Leur vision : surpasser la magnificence de Marble House, un autre manoir Vanderbilt situé non loin.
Un chef-d’œuvre architectural et artistique
Chaque détail de The Breakers témoigne d’un art de vivre grandiose. Des meubles spécialement conçus pour la maison aux décors façonnés par des artisans européens, chaque élément reflète le luxe et l’exclusivité. Cornelius Vanderbilt, dans un souci de pérennité, a même fait fabriquer suffisamment de tuiles pour le toit afin de pouvoir le remplacer trois fois.

Technologie et confort d’avant-garde
Les Vanderbilt, toujours à la pointe de l’innovation, ont équipé The Breakers des technologies les plus modernes de l’époque, telles qu’un ascenseur et un éclairage électrique. La demeure disposait également d’un système d’alimentation en eau douce et en eau salée, cette dernière étant alors considérée comme bénéfique pour la santé.
Une invitation à l’histoire et à l’élégance
Aujourd’hui, The Breakers est ouvert au public en tant que musée, géré par la Preservation Society of Newport County. C’est une invitation à explorer les différentes pièces de la maison, à plonger dans l’histoire fascinante de la famille Vanderbilt et à s’immerger dans le luxe de la fin du XIXe siècle.
Visitez The Breakers, c’est un peu vivre une expérience immersive dans une ère de prospérité et de faste inégalée. C’est aussi une occasion unique de découvrir comment vivait l’une des familles les plus riches et influentes de l’histoire américaine.